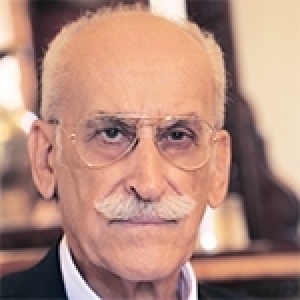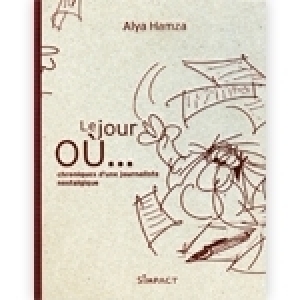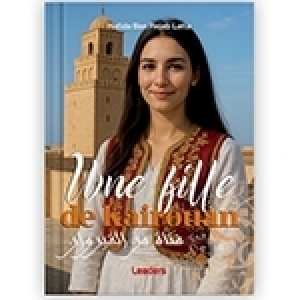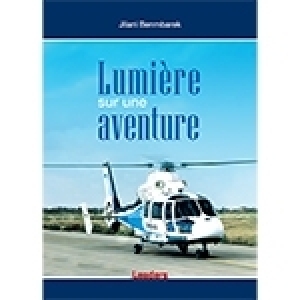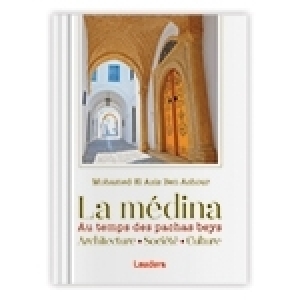Le Retour du prince de Vincent Martigny: quand l'art de gouverner change de sens et de style

électeur est désemparé. Entre démocrates libéraux et populistes autoritaires qu’il voit s’affronter dans des duels ubuesques, assassins, et qu’il croit totalement distincts les uns des autres. Entre ce pouvoir horizontal qu’il revendique en antisystème vertical oppressif et usurpateurs des droits du peuple et cette adoration du chef. Entre cet « homme fort », charismatique, rock star, éblouissant, mais qui ne tiendra guère ses promesses et ce serviteur des masses, discret, mais efficace. Entre celui qui incarne et celui qui représente. Entre l’être et le faire...
Dans ce nouveau monde qui s’installe en Tunisie comme un peu partout, les nouveaux codes de conquête météorique du pouvoir changent la donne. Les tyrannies se multiplient : du charisme, du narcissisme, du cœur, des médias, des lobbys, des contestataires sans leaders, ni programmes, ni organisations... L’art de gouverner change de sens et de style. Le «genre présidentiel» devient atypique. Exiger un superman, encore plus fort que superman, doublé d’un magicien, séducteur, l’aduler et accepter son autoritarisme, pour s’en lasser très rapidement et l’éjecter de toute répudiation : l’idée hante les esprits.
Défaite de la presse classique, obsolescence des médias conventionnels, tropisme des médias nouveaux, manipulation des réseaux sociaux, montée du storytelling en feuilletons sans fin, épuisement de la pensée politique et banalisation du parler-faux : il n’y pas qu’en Tunisie que cela se passe. Désormais dans le monde entier.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire Le Retour du prince* de Vincent Martigny. Maître de conférences en sciences politiques à l’Ecole polytechnique, il dissèque les nouveaux gènes du «Politique», qu’il s’appelle Obama, Trump, Macron, ou autres. Minutieusement, il passe au peigne fin le décor où ce nouveau prince évolue, mesurant les changements intervenus, soulignant les mystifications pernicieuses, montrant les contre-vérités flagrantes.

S’il met en exergue les dégâts de la déresponsabilisation, Vincent Martigny en fait porter le tort aux politiques, aux médias et aux électeurs. Et l’explique amplement. En guise de conclusion d’une analyse très pertinente, bien documentée, il s’interroge sur les conditions d’une nouvelle incarnation démocratique à même de repenser les institutions. Sa conviction est faite : «C’est seulement par l’édification d’une communauté civique nouvelle où le pouvoir sera redistribué et mieux partagé que nous pourrons remettre les chefs à leur place.»
Vincent Martigny, qui était venu début juillet dernier à Tunis présenter son livre à l’Agora, à La Marsa, promène son regard sur le monde. Tout en s’intéressant de près à ce qui se passe chez nous. Son essai est édifiant à plus d’un titre. Instructif.
Le retour du prince
de Vincent Martigny
Flammarion, 2019
(*) A l’exception des citations directes, les autres intertitres sont de la rédaction
Bonnes feuilles
Le spectacle de la politique se substitue aux réformes(*)
(La complexification et l’internationalisation des sociétés contemporaines, l’évolution de la démocratie d’opinion et la «culturalisation» de la politique).
Cette triple évolution modifie l’équilibre entre le récit et l’action dans l’art de gouverner. Dans un monde trop embrouillé pour que les résultats tangibles de l’activité politique puissent être directement visibles, alors que les médias convertissent le réel en narrations, et que la culturalisation des enjeux encourage les interprétations affectives, tout participe à faire triompher le récit de l’agir sur l’agir lui-même. Une tension inédite affleure : le spectacle de la politique se substituant à la mise en oeuvre de réformes concrètes, commentateurs et citoyens en sont réduits à analyser ou à incriminer le récit des actes des dirigeants plutôt que les répercussions sur leur vie quotidienne. Un tel changement dans notre rapport au réel ne peut que transformer la nature des dirigeants et celle de la compétence politique.
(***)
Des politiques rock stars
Dans ce contexte de mutation rapide des règles qui structuraient jusqu’alors la vie politique, on assiste à l’apparition de nouveaux hommes forts, à l’ascension fulgurante et non conventionnelle. Jusqu’à présent, la compétition politique consistait en une course de fond, jalonnée d’étapes et parsemée d’embûches. Elle justifiait des carrières longues, dont l’enjeu était de permettre à l’impétrant de construire patiemment un ensemble de convictions et une expérience de terrain, en vue d’acquérir les ficelles du «métier» politique, mais aussi de mobiliser les réseaux et les soutiens indispensables à l’élection. Ce monde-là est sur le point d’être révolu. Barack Obama, Donald Trump, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Pedro Sanchez, Jair Bolsonaro, Andrej Babis, Sebastian Kurz ou Matteo Salvini sont des météorites de la politique, dont l’ascension a pris de court jusque dans leur entourage. D’abord considérés comme des personnalités de second rang – quand ils n’étaient pas totalement inconnus du grand public –, ils ont gravi à pleine vitesse les escaliers du pouvoir.

(***)
Une nouvelle manière de conquérir le pouvoir
Certes, ces profils atypiques d’outsiders traduisent d’abord une lassitude vis‑à-vis des procédures électorales classiques de la démocratie représentative, qui s’ajoute au souhait de voir se renouveler les visages de la politique. Mais le processus qui a présidé à leur émergence est en réalité plus complexe. Il indique une nouvelle manière de conquérir le pouvoir et de l’exercer. Face à la triple évolution (complexification / médiatisation / culturalisation) exposée plus haut, ces dirigeants d’un nouveau type proposent des réponses inédites et distinctes de celles de leurs prédécesseurs. Ils ont d’abord pleinement intégré l’impératif d’une simplification de leur discours, qui vise à présenter des narrations accessibles et rassurantes du réel. Produits médiatiques par excellence, ils partagent en outre un sens aigu de la communication et une capacité spectaculaire à formuler un récit personnel autour de leur parcours.
Ce récit est renforcé par le soutien de la presse people et des réseaux sociaux, leviers d’une personnalisation qui peut se muer en véritable mania. Ces bêtes de scène politiques sont devenues le produit d’une «idéologie de la célébrité», qui repose sur la valorisation d’une réussite personnelle fondée sur la seule popularité.

Par ailleurs, tous ont également en commun de négliger les programmes politiques jugés aujourd’hui secondaires et rejetés dans «l’idéologie». Seule compte l’étoffe, la carrure, mise en scène à travers un récit fondé sur une trajectoire personnelle, mouillée d’émotion, qui se substitue à l’exposition d’idées. Les électeurs deviennent un public qu’il s’agit de divertir, d’émouvoir ou d’impressionner, et la vie politique un théâtre d’ombres où prévaut la stratégie. Alors que les leaders traditionnels se contentaient de cultiver des relations avec les vedettes – artistes, intellectuels ou hommes d’affaires en vue –, Macron, Obama, Trump, Trudeau ou Salvini sont devenus eux-mêmes des stars que la foule des anonymes veut toucher, embrasser, prendre en photo ou en selfie. Des célébrités dont les journaux à scandale guettent les moindres faits et gestes, mêlant vie personnelle et activité politique. Des performers que le public s’arrache dans des meetings de campagne devenus de véritables shows où l’émotion et l’adrénaline l’emportent sur la réflexion et les propositions. Des politiques rock stars, la drogue, le sexe et le rock’n’roll en moins.
(***)
L’être contre le faire
L’obsession de l’incarnation n’est pas simplement affaire de déguisements. Elle marque une métamorphose de l’exercice du pouvoir, intégralement réinvesti dans la figure du Prince et dans les spectacles qu’il met en scène pour sa propre gloire. Elle s’accompagne d’un transfert du faire, condition du changement en politique, vers l’être du gouvernant. Alors que la politique en démocratie s’était historiquement donné comme objectif de contribuer à la transformation du réel, les citoyens donnant pour mission à leurs représentants de les servir, l’extrême personnalisation s’affranchit progressivement de l’action comme horizon de l’art de gouverner. La conception classique de la représentation qui dominait jusqu’ici consistait à confier un mandat à un leader distinct de ses électeurs en vue de changer (ou de maintenir) l’ordre des choses. Cette conception s’efface aujourd’hui devant une forme nouvelle de «représentation-incarnation» : le dirigeant prétend s’identifier, de manière réelle ou sublimée, au peuple mandataire, mais sans pour autant fixer de contenu spécifique au mandat qui lui a été attribué. Une telle mutation renoue symboliquement avec la figure ancienne du monarque, censé incarner la tête de la nation, les citoyens en constituant le corps.
(***)
Une « masculinité offensive »
Le « genre présidentiel » reste ainsi essentiellement masculin. Il prend chez les nouveaux Princes deux allures distinctes : celle du gendre idéal (Obama, Trudeau, Macron, Sanchez, Kurz), caractérisé par sa «fraîcheur» et sa jeunesse dans un univers politique longtemps considéré comme le territoire d’une élite socialement homogène constituée de mâles blancs âgés, et jouant éventuellement la carte d’une démocratie plus « féminine », en ce qu’elle permet l’usage d’émotions traditionnellement réfrénées dans l’espace public par les hommes de pouvoir. À l’inverse, le leader peut choisir d’endosser une «masculinité offensive», voire «mascarade», à travers une exhibition caricaturale des critères de la virilité (Berlusconi, Sarkozy, Trump, Bolsonaro, Orban, ou Erdogan). Dans certains systèmes politiques, la demande de proximité peut également prendre des formes fusionnelles entre le Prince et le peuple. Il n’est alors plus question d’incarner «l’homme du peuple» mais «l’homme-peuple».

(***)
«Bains de selfies »
Les citoyens émettent le souhait de voir les gouvernants de plus près, de les observer à hauteur d’homme, à portée d’appareil photo. En France, en Italie ou aux États-Unis, un tel phénomène s’exprime dans les bains de foule auxquels ils se livrent, d’ailleurs progressivement transformés en «bains de selfies», comme si le toucher ne suffisait plus et qu’il fallait conserver une image de ces célébrités mondiales que sont devenus les Princes.

(***)
Un espace public remodelé et élargi
Amplifiée à l’infini par les réseaux sociaux, la société du spectacle médiatique «pilonne le temps», selon l’expression de l’écrivain Sylvain Tesson, et transforme notre rapport à la réalité. Nous partageons désormais un sentiment permanent d’urgence et de crise, mais aussi une forme d’insécurité et de malaise face à ce qui nous semble une dramatisation du monde lui-même. La mise en scène de l’actualité par les médias a depuis longtemps pris l’aspect d’un ensemble de menaces et d’espoirs bien éloignés de la vie quotidienne de ceux qui les observent. Elle promeut des événements et des enjeux qui n’auraient parfois jamais retenu notre attention s’ils n’avaient été valorisés de manière artificielle et délibérée.
Ce bouleversement médiatique, accentué par la révolution numérique, a des conséquences directes sur notre rapport au pouvoir et à la participation politique. Il a élargi et remodelé l’espace public né avec les libelles à la fin du XVIIe siècle, engendrant une nouvelle irruption des masses dans le jeu démocratique. Jusqu’ici relativement passifs face à l’information, les citoyens disposaient d’une participation politique limitée, essentiellement centrée sur le vote, auquel venait s’adjoindre une palette de possibilités supplémentaires allant de la simple discussion politique à l’engagement dans un parti ou à la manifestation publique.
(***)
Se substituer aux élites politiques traditionnelles
La participation ne garantit pas non plus l’égalité dans la prise de parole sur les réseaux. Twitter n’a pas fait disparaître les leaders d’opinion mais a, au contraire, renforcé leur visibilité. Alors qu’un intellectuel ou un journaliste qui publiait un article dans un quotidien ou une revue de référence était jusqu’alors très peu confronté à ses lecteurs, il reçoit aujourd’hui potentiellement des centaines, voire des milliers de commentaires ou de partages. À cela s’ajoute l’émergence sur les réseaux sociaux de relais d’opinion d’un type nouveau: les activistes et les célébrités. Les premiers, fortement engagés dans une cause, surinvestissent cette nouvelle agora et tentent de mobiliser les citoyens, voire de nourrir leur colère ou leur adhésion sur un enjeu précis. Les seconds sont des personnalités du monde culturel ou médiatique, sans compétence sociale ou politique particulière, dont l’opinion est partagée sur les réseaux en vertu de leur seul statut. Ces derniers en sont venus à jouer un rôle déterminant et parfois même à se substituer aux élites politiques traditionnelles.
(***)
«Écrire des livres, oui ; en lire, non»
Plusieurs facteurs expliquent cet épuisement du langage en démocratie. Le déclin des idéologies a entraîné une méfiance vis‑à-vis des références intellectuelles ou historiques trop marquées, qui semblent autant de carcans enfermant une action déjà passablement contrainte par le réel. Alors que les dirigeants de la fin du XXe siècle ont largement abusé des symboles politiques pour compenser leur incapacité à transformer la réalité économique et sociale, le contraste entre discours et actes a progressivement décrédibilisé le « dire » comme moteur du «faire». Autres éléments d’analyse, la théâtralisation de la vie politique et son accélération liée à celle de l’agenda médiatique. Il faut aller vite, alors même qu’il n’y a pas d’espace pour l’expression d’idées complexes, de propos construits. À cela s’est ajoutée l’incapacité croissante du monde politique à produire de la pensée, qui a contribué à la neutralisation du langage, à sa simplification et à son affadissement. Le déclin de l’écrit s’est accompagné d’un mouvement paradoxal du personnel politique dans sa relation aux livres et aux idées, que l’on pourrait résumer par une formule : «Écrire des livres, oui ; en lire, non.» La prise de contrôle du discours technocratique et économiste sur la sphère politique a fait le reste : le triomphe des politiques publiques et de la gouvernance sur les idées a figé le discours en le technicisant.
(***)
«L’ère de l’arc narratif»
La politique, déjà structurellement théâtrale, a assimilé le principe du feuilleton, l’importance de l’émotion et, par-dessus tout, la dimension centrale de la série : l’arc narratif. Lors de l’élaboration d’une série, les scénaristes construisent pour chaque personnage un ensemble de sous-histoires qui nourrissent la trame principale. Ces arcs narratifs permettent de retarder la résolution finale de l’intrigue en tenant le spectateur en haleine, construisant des récits à multiples niveaux.
Dans les démocraties contemporaines, l’arc narratif est devenu l’une des manières de contrôler l’agenda médiatique et politique. La capacité à réussir leur mandat est la première storyline (le schéma narratif) des dirigeants politiques : à partir de leur élection, ils reportent la résolution des véritables enjeux en captant l’attention du spectateur-électeur avec des sous-histoires mêlant personnalisation et objectifs intermédiaires, dont l’objet est d’entretenir l’espoir d’une résolution ultime de l’intrigue principale – en d’autres termes, l’obtention de résultats tangibles.
Dès lors, l’objectif de l’action publique devient essentiellement l’entretien d’un capital narratif du pouvoir exécutif, en fournissant des histoires qui sont autant d’arguments censés justifier les raisons pour lesquelles le travail fourni et les résultats obtenus ne sont pas immédiatement perceptibles par le plus grand nombre. Cette dimension nouvelle est d’autant plus accentuée que la croyance dans le succès ou l’échec des dirigeants figure parmi les plus arbitraires des convictions politiques. La complexification de l’exercice de l’État et, au-delà, de la vie sociale tout entière, a ouvert la voie à une ère du doute généralisé sur l’efficacité de la politique.
(***)
La cause directe de notre déresponsabilisation
Nous sommes pétris de certitudes familières selon lesquelles certains individus seraient plus aptes à diriger en raison de leurs vertus (courage, esprit d’initiative, sens du sacrifice et de l’intérêt général) . Penser que l’aptitude au commandement, qui permet à certains de s’élever au-dessus de leurs semblables, serait naturelle, ou révélée par les circonstances, revient à exprimer des lieux communs qui ne sont pas assez mis en question. L’impuissance, qui est le lot de la plupart des citoyens, a alimenté jusqu’ici le besoin de croire en des chefs porteurs d’espérance et capables de se mesurer à des forces complexes. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La gratification psychologique que nous procure le leadership est la cause directe de notre déresponsabilisation, fondée sur l’idée que les chefs sont à même de gérer des problèmes trop complexes ou trop imprévisibles à notre place. Démunis face à des problèmes trop abstraits, nous pouvons facilement nous projeter dans des individus auxquels nous attribuons des qualités ou des défauts essentialisés : représentant alternativement le bien ou le mal, ils nous délivrent de la lourde charge de devoir prendre notre part dans la destinée collective. Il est dès lors facile de les soutenir ou de les rejeter, de les adorer ou de les haïr, puisqu’ils portent sur leurs épaules les vertus, les faiblesses, et surtout les devoirs dont nous ne souhaitons pas nous encombrer. En retour, nous leur confions le pouvoir de nous diriger et donc de nous demander des sacrifices auxquels, en vertu de la légitimité démocratique de leur autorité et de la loi sur laquelle il repose, nous consentons.
(***)
«Qu’ils s’en aillent tous», qu’ils «dégagent»
Ces doutes ont conduit à l’accélération du cycle illusion-déception qui structure nos démocraties. Plus grandes les illusions, plus graves les déceptions sur la capacité des nouveaux Princes à « changer la vie ». À moins qu’une dérive autoritaire, telle qu’elle s’exprime en Turquie, en Pologne ou en Hongrie, stabilise le pouvoir au détriment de la majorité, nous nous lassons bien vite de ces Princes que nous avons portés aux responsabilités sans avoir assez réfléchi à leurs idées, à leur compétence, et aux responsabilités écrasantes que nous leur confions. Après les avoir adulés, voilà que nous souhaitons «qu’ils s’en aillent tous», qu’ils «dégagent», selon la formule née pendant la révolution tunisienne, et qui depuis a fait florès des deux côtés de la Méditerranée.
(***)
«La confiscation de la notion de peuple par les populismes autoritaires»
Des courants politiques d’un type nouveau, le plus souvent situés à l’extrême droite, apparaissent en réaction à une homogénéisation des différences idéologiques entre les partis qui occupent l’espace central de la vie politique. Longtemps confinés à une posture contestatrice et protestataire, ces mouvements accèdent au pouvoir depuis quelques années, tant en Europe (Hongrie, Pologne, République tchèque), qu’en Inde, en Turquie ou aux États-Unis. Ils sont aujourd’hui perçus comme la principale menace à l’égard de la démocratie libérale.
La confiscation de la notion de peuple par les populismes autoritaires entraîne deux mouvements parallèles. Le premier consiste en une construction symbolique d’un peuple en adéquation avec l’idéologie du parti au pouvoir. Le régime populiste «se crée le peuple au nom duquel il s’est toujours exprimé et a toujours agi» : un peuple aux couleurs chrétiennes-nationales du Fidesz de Viktor Orban en Hongrie ou du parti Droit et Justice (PiS) d’Andrzej Duda en Pologne, un peuple ultraconservateur et anti-islam à l’image du parti nationaliste BJP en Inde ou libertarien et réactionnaire comme le Tea Party américain, qui a contribué à porter Donald Trump à la présidence. Le second mouvement consiste en la mainmise quasi systématique des populistes sur l’État après la prise du pouvoir. Puisque ces mouvements se veulent l’expression exclusive du peuple et leur leader son émanation directe, l’administration est sommée de servir ses nouveaux maîtres sans les possibles recours que prévoit généralement l’État de droit. Cette appropriation de l’État s’accompagne d’ordinaire de mesures visant à restreindre les libertés et à empêcher la délibération, à commencer par le démantèlement et le musellement de la presse. Le populisme autoritaire se maintient ainsi au pouvoir par une double manoeuvre d’éviction du débat démocratique et de «clientélisme de masse». La redistribution sociale devient une monnaie d’échange pour s’assurer la loyauté des citoyens.
(***)
« Le phantasme du peuple-un »
Dans une société où les fondements de l’ordre politique et de l’ordre social se dérobent, où l’acquis ne porte jamais le sceau de la pleine légitimité, où la différence des statuts cesse d’être irrécusable, où le droit s’avère suspendu au discours qui l’énonce, où le pouvoir s’exerce dans la dépendance du conflit, la possibilité d’un dérèglement de la logique démocratique reste ouverte. Quand l’insécurité des individus s’accroît, en conséquence d’une crise économique, ou des ravages d’une guerre, quand le conflit entre les classes et les groupes s’exaspère et ne trouve plus sa résolution symbolique dans la sphère politique, quand le pouvoir paraît déchoir au plan du réel, en vient à apparaître comme quelque chose de particulier au service des intérêts et des appétits de vulgaires ambitieux […] alors se développe le phantasme du peuple-un, la quête d’une identité substantielle, d’un corps social soudé à sa tête, d’un pouvoir incarnateur, d’un État délivré de la division..
- Ecrire un commentaire
- Commenter

.jpg)