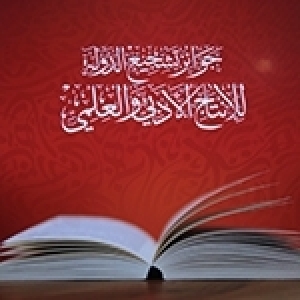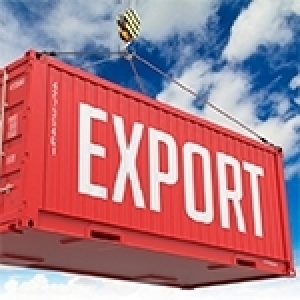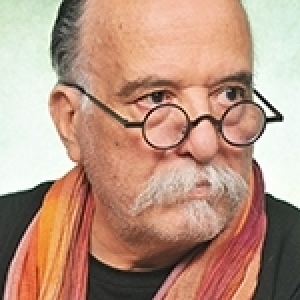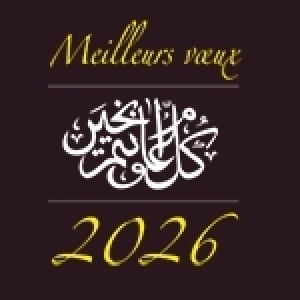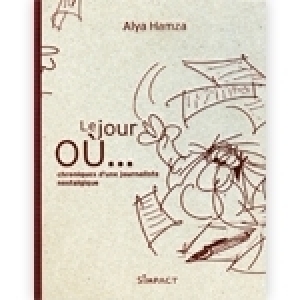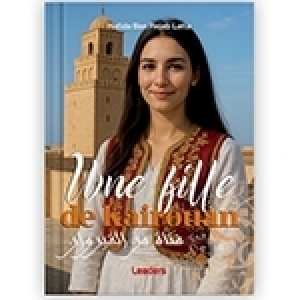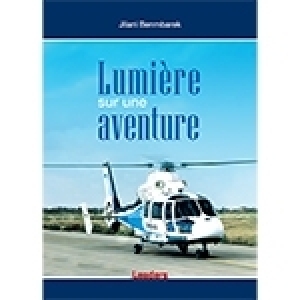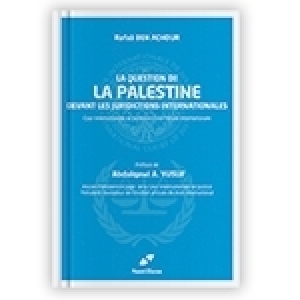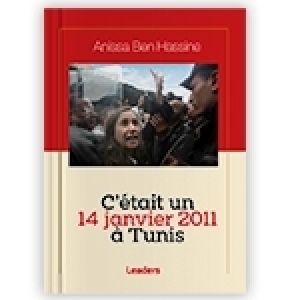Document – La conférence de l’Ambassadeur Ahmed Ounaïes sur « L’ordre régional et international de notre temps »
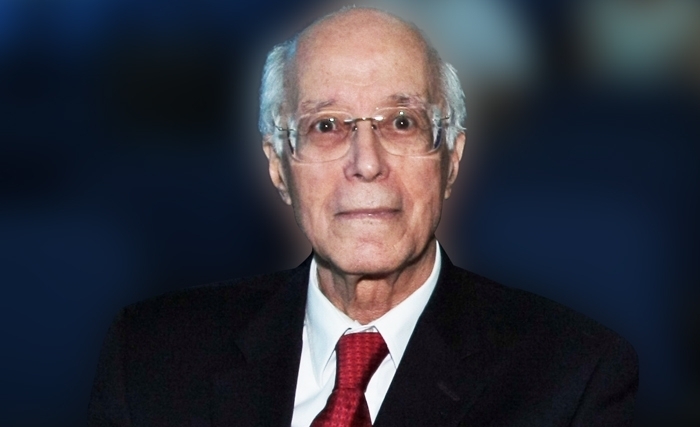
«Le génocide, le non règlement des conflits et le déclin des Institutions internationales constituent un échec collectif de l’ordre de notre temps», estime l’ambassadeur Ahmed Ounaïes. Dans une conférence donnée vendredi 10 octobre 2025 à la tribune de l’Association Béchir Salem Belkhiria pour la science et la culture et de l’Amicale des anciens élèves du cycle supérieur de l’ENA, l’ancien ministre des Affaires étrangères brosse un tableau analytique perspicace de «L’ordre régional et international de notre temps».
Tour-à-tour, il passe en revue trois facteurs déterminent le tableau présent des relations internationales, à savoir la réélection de Donald Trump le 5 novembre 2024 (mandat 2025-2028), l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Russie (24 février 2022) et la question palestinienne. L’ambassadeur Ounaïes rappelle les principaux développements en 2025, revient aux origines de l’ordre mondial établi à la sortie de la deuxième guerre mondiale, évalue le rapport des forces et se concentre sur trois questions majeures. Il s’agit de la guerre en Ukraine, du génocide perpétré à Gaza et de la situation du Grand Maghreb arabe. Au sujet de la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, il propose que le Veto soit valide seulement avec 2 votes et non plus un seul.
Texte intégral
Trois facteurs déterminent le tableau présent des Relations Internationales:
• Réélection de Donald Trump le 5 novembre 2024 (mandat 2025-2028);
• Invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Russie (24 février 2022);
• Relativement à la question Palestinienne:
- Les Accords d’Abraham (août 2020 – janvier 2021) ayant entraîné 4 pays arabes à normaliser avec Israël (EAU, Bahreïn, Maroc et Soudan);
- Coup d’éclat de la résistance Palestinienne le 7 octobre 2023 contre la menace de liquidation de la question palestinienne;
- Cinq jugements de la CIJ en 2024: 26 janvier, 16 février, 28 mars, 24 mai et 19 juillet; ils s’ajoutent au jugement du 9 juillet 2004 sur le Mur de séparation édifié par Israël à Jérusalem;
- La CPI émet les 21 et 26 novembre 2024 trois mandats d’arrêt contre Mohamed Deif (Commandant des Brigades Al-Qassam) et contre deux israéliens (Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant) en tant que criminels de guerre. Les décisions des deux Cours restent lettre morte.
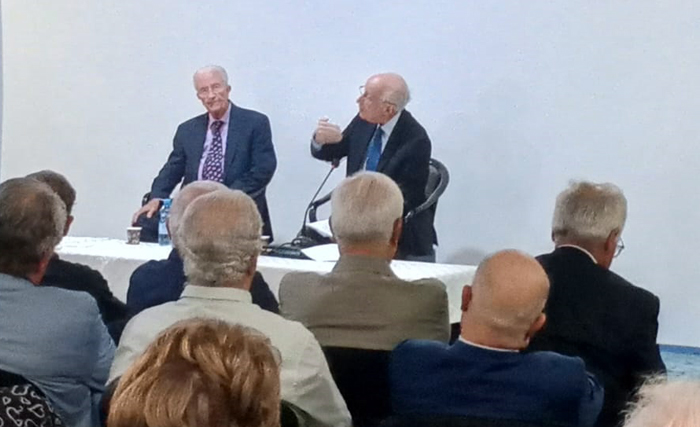
Les principaux développements en 2025
• Création du Groupe de La Haye, le 31 janvier 2025, par 10 pays, sans aucun pays arabe, à l’initiative de la Colombie et de l’Afrique du Sud (+ Cuba, Belize, Bolivie, Honduras, Namibie, Sénégal, Namibie et Malaisie). Déclaration de Bogota 16 juillet.
• Guerre contre l’Iran par Israël et USA (13-24 juin 2025);
• Guerre contre le Yémen où éclate une véritable guerre de missiles;
• Israël bombarde le 9 septembre Qatar, pourtant ‘‘major ally non NATO member’’;
• Génocide: le 12 décembre 2023, la Fédération internationale pour les droits humains qualifie les actes de l’armée israélienne à Gaza de génocide. Francesca Albanese, Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme pour les territoires occupés, documente le génocide dans son rapport intitulé « Situation des droits humains dans les territoires occupés depuis 1967 » daté 2 juillet 2025 ; Navi Pillay, ex Haut-Commissaire pour les DH, présente ce rapport le 16 septembre;
• L’AGNU approuve le 12 septembre 2025 la formule de règlement des deux Etats par une majorité supérieure aux deux tiers: 142 voix contre 10 et 12 abstentions (les dix sont : Israël, USA, Argentine, Paraguay, Hongrie, Micronésie, Nauru, Palaos, Papouasie, Tonga);
• Cette Résolution est précédée de la Déclaration de New York (42§), proclamée le 29 juillet 2025, à l’initiative de la France et de l’Arabie Saoudite (28-30 juillet 2025) et qui pose les éléments essentiels du règlement de fond et de la solution à deux Etats; 17 pays y ont participé activement;
• 47e veto US le 18 sept 2025 contre le cessez-le-feu à Gaza, 6e depuis 7 oct 2023;
• Conférence de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine: 21 septembre au lieu de 17-20 juin sous présidence Arabie / France;
• Percée remarquable des reconnaissances de l’Etat de Palestine: Royaume Uni, Canada, Australie, Portugal, France, Belgique, Luxembourg, Malte, Andorre, St Marin; à ce jour 156 Etats membres de l’ONU + Vatican et RASD;
• 7e Ambassade à Jérusalem : Fidji le 17 septembre (USA, Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo, Papouasie et Fidji) en violation des Résolutions du Conseil de Sécurité 476 du 30 juin 1980 et 478 du 20 août 1980;
• Flottille Sumoud : acte de solidarité internationale avec Gaza, initiative lancée en juillet, voguant depuis le 1er septembre, avec 400 participants (dont 25 tunisiens) de 44 nationalités ; la flottille est interceptée les 2 et 3 octobre à la limite des eaux territoriales par la flotte militaire israélienne: 42 embarcations;
• Le Plan Trump pour Gaza (29 sept 2025) esquisse, en contrepartie de la libération des otages (48 restants), la fin de l’offensive israélienne, un régime transitoire et évoque le futur Etat Palestinien ; Hamas répond le 3 octobre, acceptant la libération des otages et se disant prêt à négocier les détails et à céder l’administration de Gaza à une autorité palestinienne. Accord Israël-Hamas 9 oct.
L’ordre mondial
Depuis 1945, l’ONU et la famille des NU structurent la politique générale de coopération internationale, sans parvenir ni à l’universalité, ni à la stabilité.
Au cours de la décennie 1990, l’ordre politique mondial passait d’une structure bipolaire à un processus de transition où s’affirme le pôle occidental – qui compte désormais une quarantaine de pays, incluant, en plus de l’OTAN, de nouvelles formations intercontinentales.
Tandis que s’estompe la dualité Libéralisme / Socialisme, s’esquisse un recentrage géopolitique qui repose en principe sur deux axes : Nord-Sud et radicalisme anti occidental. Le Tiers-monde, qui se revendiquait depuis la décennie 1960 comme Mouvement Non Aligné et Groupe des 77, s’insère désormais dans l’ensemble qualifié de Sud Global. Cette qualification s’explique non par la dissipation du noyau politique du Mouvement, mais par la mise en question de sa pertinence conceptuelle : le trait marquant du Sud Global est qu’il inclut la Russie et la Chine.
Le Tiers-monde, qui se revendiquait depuis la décennie 1960 comme Mouvement Non Aligné et Groupe des 77, s’insère désormais dans l’ensemble qualifié de Sud Global. Cette qualification s’explique non par la dissipation du noyau politique du Mouvement, mais par la mise en question de sa pertinence conceptuelle : le trait marquant du Sud Global est qu’il inclut la Russie et la Chine.
Le nouveau tableau de l’ordre mondial se présente ainsi:
• Le pôle occidental: Communauté de civilisation, culture démocratique, économie libérale, puissance militaire. Sous l’angle stratégique, retenons la victoire de ce camp face à l’URSS et l’absence d’une entente sur la question de l’Euro-Sécurité.
L’acquis de la CSCE – Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe – d’août 1975 à Helsinki est raisonnablement appelé à une mise à jour radicale.
Le pôle occidental comprend désormais l’OTAN élargie (16 membres en 1999, 32 en mars 2024) + AUKUS (15 septembre 2021) + Duopole Israël-USA + Accords bilatéraux; rappelons la dissolution de l’OTASE (8 sept 1954-30 juin 1977) et du Pacte de Bagdad ou CENTO (20 février 1955-16 mars 1979) ;
• Le corps même du Sud Global : acteur en tant que tel (130 pays ?) ;
• Les BRICS (10 pays membres) 5 + 5 (Indonésie, Iran, EAU, Egypte, Ethiopie) ;
• L’Organisation de Coopération de Shanghai (10 pays membres): Instituée le 15 juin 2001 par la Chine, la Russie et 4 États d'Asie centrale – Kazakhstan, Kirghizie, Ouzbékistan et Tadjikistan – elle s'élargit à l'Inde et au Pakistan en 2016, puis à l'Iran en 2021 et enfin à la Biélorussie le 4 juillet 2024.
Rappelons que les anciens alliés du Pacte de Varsovie (15 mai 1955 – 1 juillet 1991) ont adhéré progressivement à l’OTAN, tandis que la Russie forme le 7 octobre 2002 l’OTSC : Organisation du Traité de Sécurité Collective qui compte actuellement 5 pays membres d’Europe orientale et d’Asie centrale : Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizie et Tadjikistan (retrait de l’Arménie et de l’Ouzbékistan). Face à l’OTSC, le GUAM, constitué en Europe centrale et orientale (1996-1997), regroupe la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie.
Face à l’OTSC, le GUAM, constitué en Europe centrale et orientale (1996-1997), regroupe la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie.
Cette structuration marque la scène mondiale par-delà les regroupements politiques régionaux et sous-régionaux : Union Africaine, Organisation des Etats Américains, Union Européenne, Ligue des Etats Arabes, APEC et ASEAN.
Ce tableau recèle quatre grandes questions
• Non règlement de la question de Palestine;
• Retour de la guerre sur le théâtre européen (Ukraine) et sa durée (4e année);
• Le retour de la politique de puissance et l’affaiblissement des Institutions internationales fondées sur la suprématie du droit;
• Quelle réforme pour l’ONU, notamment la réforme du Conseil de Sécurité?
A partir de la Tunisie, nous nous demandons
Les conflits sanglants qui se poursuivent sous nos yeux en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (Guerres civiles au Soudan et en Libye), sans perspective apparente de paix, mais qui recourent tous aux moyens militaires, perpétuent la violence et esquissent une nouvelle forme de guerre. La perpétuation des conflits reflète la fragilité de la carte politique présente; en outre, la volonté de paix est inégale chez les puissances mondiales, celles qui assument au sein des NU une responsabilité spéciale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Sans doute aussi la maturité des valeurs universelles est-elle incertaine: les puissances qui détiennent les moyens de destruction les plus avancés s’en détachent et s’estiment à l’abri des retombées ultimes de la guerre.
Pas plus que l’éthique, l’art politique n’a guère évolué au XXIème siècle.
Voyons de plus près trois sujets qui retiennent notre intérêt sous l’angle tunisien.
La guerre en Ukraine
A la base, le Sommet de l’OTAN d’avril 2008 à Bucarest avait proclamé le principe de l’admission au sein de l’alliance de la Géorgie et de l’Ukraine. La même année, une guerre opposait la Russie à la Géorgie (août 2008). Cette guerre aboutit au détachement de deux provinces géorgiennes, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, devenues indépendantes, et où la Russie maintient désormais des forces militaires.
En Ukraine, la crise d’Euromaïdan (Novembre 2013-Février 2014) marquée par des manifestations populaires pro-européennes, aboutit à la destitution du Président pro-russe Victor Yanoukovic (qui s’est réfugié en Russie) et à un Referendum en Crimée (16 mars) au terme duquel la Crimée signe un Traité avec la Russie (18 mars) et devient partie intégrante de la Fédération de Russie. En avril, d’autres provinces, le Donbass (7 avril) et Louhansk (27 avril) se proclament Républiques indépendantes. Dès lors, la situation de l’Ukraine est fragile. Deux questions:
• Pourquoi la guerre?
• Au sommet de l’Alaska le 15 août dernier (Poutine-Trump), trois conditions sont posées par la Russie pour l’arrêt des combats:
1- Pas d’élargissement de l’OTAN (le quasi verrouillage de la Mer Baltique pourrait, en cas d’extension de l’OTAN, s’étendre à la mer Noire);
2- Statut de neutralité pour l’Ukraine;
3- Protection des droits des russophones.
La première condition concerne l’extension du champ de l’OTAN. La réunification Allemande (3 octobre 1990) avait rapproché l’OTAN du territoire russe, mais elle était négociée avec l’URSS.
Après l’entrée de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchéquie (12 mars 1999), il est clair que l’Alliance, portée alors à 19 membres, était aux frontières de la Russie. Jusqu’en mars 2020, 11 autres pays adhèrent encore à l’OTAN, notamment les trois pays Baltes. Dès lors, la Russie est en état d’alerte, sachant la décision de l’OTAN d’admettre le principe de l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie. L’Ukraine souveraine pourrait à tout moment saisir l’offre d’adhésion.
L’extension même de l’OTAN et le rythme de son expansion posent le problème de l’Euro-Sécurité, sur les frontières continentales et sur les frontières maritimes en Mer Baltique et en Mer Noire.
Lors du Conseil OTAN-Russie le 12 janvier 2022 à Bruxelles, la délégation Russe posait clairement le problème devant les 30 membres que comptait alors l’OTAN et, à l’issue de la session, estimait que les échanges relatifs aux garanties de sécurité avaient été infructueux. Le précédent Géorgien de 2008 prenait alors tout son sens. La première condition posée par la Russie au Sommet de l’Alaska le 15 août dernier nous semble justifiée.
Le rapport de force
• Fin février 2025, la guerre d’Ukraine entre dans sa 4e année. Les forces armées de la Russie semblent bloquées. La puissance supposée des deux belligérants est en question, même s’ils s’en tiennent à une guerre classique et s’abstiennent de recourir aux armes de destruction massive.
La question se pose quant à l’option de guerre d’usure et quant à la valeur de la modernisation de l’armement classique. Même si la Russie a mis en alerte son dispositif nucléaire, le risque nucléaire est-il est exclu?
A cette date, la Russie a déjà satisfait des objectifs territoriaux significatifs: l’occupation du littoral Nord de la Mer d’Azov qui lui assure la continuité territoriale entre ses frontières Ouest et la péninsule de Crimée, déjà rattachée en mars 2014. Des referendums organisés dans les provinces conquises (23-27 septembre 2022), consolident l’acquis bien qu’ils soient contestés par ailleurs. Il est clair que la maîtrise totale de la Mer d’Azov est un atout stratégique. L’autre atout est l’expérimentation de certaines armes modernes (drones et missiles).
Le ralentissement des opérations signifie ainsi que la Russie se fixe désormais non plus un objectif territorial, mais la validation de l’acquis. Ce calcul vient d’être cautionné par le SE Défense US, Pete Hegset qui, le 12 février 2025 à Bruxelles, estimait «irréaliste un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014». C’est une première réponse. La déclaration de Hegset semble ménager une voie pour une paix négociée et, plus au fond, la base d’une future négociation sur la sécurité européenne. Le non-dit est le risque nucléaire.
Le fait même de la guerre, à notre sens, est le prélude d’une nouvelle initiative sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki II). Telle est, vraisemblablement, la finalité de l’aventure ukrainienne froidement déclenchée en février 2022.
• Pour nous Tunisiens, l’acquisition de territoire par la force est un défi à la suprématie du droit. Si la Russie obtient des satisfactions territoriales, quelle qu’en soit l’ampleur, le précédent ouvre la voie aux prétentions expansionnistes d’Israël. Est-ce à dire que l’Administration Trump joue cette carte délibérément et qu’elle veuille se donner un précédent, même au détriment de l’Europe ? A ce titre, la guerre d’Ukraine est certes un test de doctrine pour l’OTAN.
Cette guerre aura représenté le passage obligé de l’ordre européen vers un nouvel Accord d’entente et de sécurité répondant au nouveau rapport de force.
La guerre de Gaza
La guerre à Gaza, lancée en octobre 2023, est l’un des épisodes du non règlement de la question Palestinienne. Retenons à ce stade les faits nouveaux.
• Le Génocide et la famine; Gravissime!
• La Déclaration de New York (42 §) proclamée le 29 juillet 2025;
• La Résolution sur la solution à deux Etats adoptée le 12 septembre 2025 par l’AGNU avec 142 voix contre 10 & 12 Abstentions; l’initiative France-Arabie Saudite entraîne 10 annonces solennelles de reconnaissance de l’Etat de Palestine. Il est vraisemblable que le Plan Trump en 20 points annoncé le 29 septembre soit la réplique du duopole Israël-USA afin d’imposer un processus contrôlé par Trump, avec l’accord contraint de 8 pays arabo-islamiques;
• L’élan de reconnaissance de l’Etat de Palestine aboutit à 156 pays membres des Nations Unies; cet élan répond à deux impératifs devenus pressants: d’une part, la proclamation publique de certains dirigeants Israéliens menaçant d’annexer Gaza et d’autre part, la révision d’une conviction non avouée mais ancienne que la Palestine est une terre juive ; la formule de partition du territoire adoptée en 1947 (Résolution 181 du 29 novembre 1947) émanait de cette conviction;
• Israël poursuit à Gaza une opération d’extermination ethnique. Les offensives militaires du duopole contre le Yémen (guerre de missiles) et contre la prétendue menace nucléaire en Iran (13-24 juin 2025) signifient qu’Israël et les Etats-Unis recourent à la guerre pour préserver la suprématie militaire d’Israël qui, par ailleurs, détient le monopole nucléaire dans la région;
• La flottille Sumoud, initiative civile, non militarisée, défie au nom du droit humanitaire le blocus imposé à Gaza, avec pour objectif de lui porter secours contre la famine; la flotte israélienne a stoppé la flottille à la limite des eaux territoriales (2-3 octobre). L’aventure a impliqué la Tunisie : arrêt dans les ports tunisiens et des attaques de drones (8 et 9 septembre); la flottille Sumoud (42 embarcations, 400 participants, 44 pays) a contribué à aggraver l’isolement d’Israël;
• Le plan Trump pour Gaza (29 septembre 2025) mentionne expressément l’Etat de Palestine (§ 19): «ouvrir une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien, ce que nous reconnaissons comme l’aspiration du peuple palestinien.» Le Pdt George Bush déclarait le 10 novembre 2001 à la tribune de l’AGNU: «Nous œuvrons pour le jour où deux Etats, Israël et la Palestine, vivent ensemble paisiblement dans des frontières sûres et reconnues»: un pas de plus !
La Résistance
Sur le fond, deux points subsistent : la résistance et la question territoriale. La relation entre la puissance occupante et le peuple victime de l’occupation est une relation de violence. La résistance opposée aux forces d’occupation est légitime. Ainsi avaient réagi les peuples européens victimes de l’occupation pendant la IIème Guerre Mondiale. Roosevelt et les alliés étaient solidaires des peuples victimes de l’occupation, non de la puissance occupante. Pourquoi donc la résistance Palestinienne, luttant contre l’occupation, est-elle qualifiée de terrorisme ?
La clarification s’impose également quant à la qualification d’otage : la puissance occupante exerce le droit de vie et de mort sur le peuple Palestinien victime de l’occupation. 10.800 prisonniers sont détenus dans les prisons israéliennes à la date d’août 2025. Pourquoi donc les prisonniers de la Résistance Palestinienne sont-ils qualifiés d’otages ? Ne sont-ils pas tout simplement des prisonniers de la Résistance Palestinienne ?
La question territoriale
Le statut présent de la Palestine aux NU est celui du Vatican: État non membre observateur ; mais à la différence du Vatican, qui dispose d’un territoire symbolique, la Palestine puise dans les Résolutions des NU une expression territoriale incluant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. L’issue de la question territoriale détermine l’avènement de la paix. Voici les positions en présence:
• Israël s’en tient à la négation de principe de l’État de Palestine ;
• Le Président Donald Trump, au nom des Etats-Unis, a déjà transgressé la légalité internationale relativement à Jérusalem-Est (6 décembre 2017) et au Golan (25 mars 2019), en reconnaissant leur rattachement à l’État d’Israël. En outre, Mike Pompeo, Secrétaire d’Etat, déclare le 18 novembre 2019 que les colonies israéliennes installées dans les territoires occupés ne sont plus considérées par les Etats-Unis comme contraires au droit international ; cette décision annule l’avis juridique du State Department de non-conformité au droit international en vigueur depuis 1978. Les USA ont changé leur législation sur ce point. Ainsi, le duopole se distingue-t-il du reste du monde relativement à la question territoriale.
• Les autres pays occidentaux déclarent que la question de la délimitation territoriale doit être tranchée par la négociation entre les deux parties, Israël et la Palestine;
• Le Plan de Paix arabe adopté le 27 mars 2002 au sommet de Beyrouth revendique l’ensemble des territoires occupés en juin 1967 en tant que territoires Palestiniens;
• Les ordonnances de la CIJ (2004 et 2024) consolident la thèse arabe. La Tunisie sur ce point a évolué depuis les élections d’octobre 2019 : elle s’est radicalisée;
Dernier aspect : l’issue de la guerre d’Ukraine peut constituer un précédent juridique relativement à la doctrine des pays d’Europe occidentale.
• La reconnaissance de l’État de Palestine ne préjuge pas de l’intégrité des territoires palestiniens. En revanche, les jugements clairs et cohérents de la CIJ renforcent la thèse Palestinienne sur le fond et, notamment, sur l’aspect territorial.
Paradoxe: l’arrogance et les abus du duopole israélo-américain pourraient provoquer une nouvelle dynamique de règlement de la question de Palestine.
L’Union Maghrébine
Le Non Maghreb et la résignation au Non Maghreb signifient un échec stratégique. Pour nous, prétendre changer le monde requiert au préalable de fonder le Maghreb. La question se pose de savoir si l’appel du Maghreb subsiste assez largement dans la jeune génération. A ce stade, notre échec affecte la capacité globale de la Communauté arabe.
Au cours des premières décennies de l’indépendance, prévalait un sentiment d’optimisme fondé sur la confiance dans la réalisation du Grand Maghreb, conçu comme la grande patrie. Un facteur subconscient faisait du projet Maghrébin à la fois un horizon au-delà de l’indépendance nationale et la parade à la puissance du camp occidental.
Le Grand Maghreb répond à trois impératifs:
• Stabilité : Maghreb à cinq, ni trois, ni six; Reconnaissance des frontières ; Barrage face aux velléités hégémoniques;
• Un marché compétitif de 100 millions de consommateurs;
• Se hisser aux normes de notre temps: la clarté stratégique, les grands ensembles régionaux et l’édification d’un avenir crédible.
Signalons deux réalisations positives:
• Le Traité de Marrakech qui fonde l’UMA (17 février 1989);
• La permanence du Secrétariat Général de l’UMA, basé à Rabat et assuré depuis octobre 1991 successivement par cinq Tunisiens : Mohamed Amamou, Habib Boularès, Habib Ben Yahia, Taïeb Baccouche et, depuis le 1er juin 2024, par Tarak Ben Salem. Le Secrétariat Général symbolise la vivacité de la flamme Maghrébine en nous-mêmes. Son maintien en dépit du gel de l’UMA six ans après sa fondation (Echange de lettres Filali / Dembri 20-24 décembre 1995), et en dépit de la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc (24 août 2021), est une source d’espoir.
Quelle réforme du Conseil de Sécurité?
Nous proposons que le Veto soit valide seulement avec 2 votes et non plus un seul.
Conclusion
Le génocide, le non règlement des conflits et le déclin des Institutions internationales constituent un échec collectif de l’ordre de notre temps.
Ahmed Ounaïes
10 octobre 2025
- Ecrire un commentaire
- Commenter