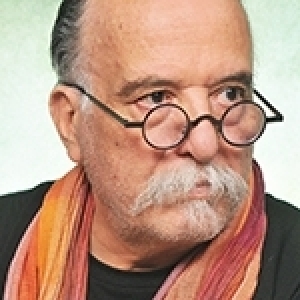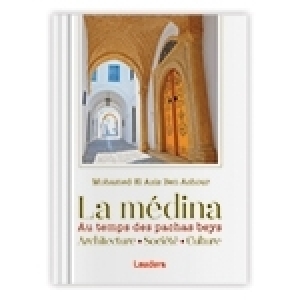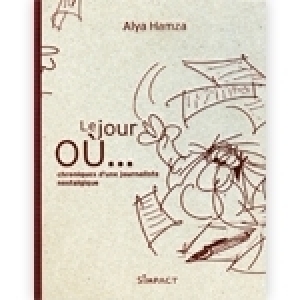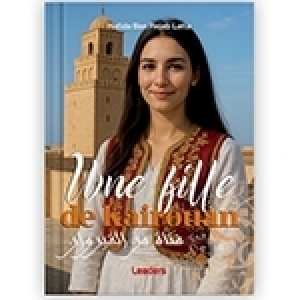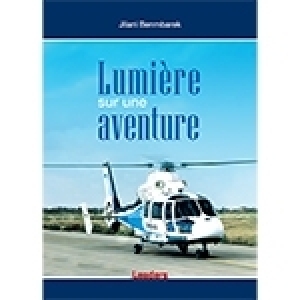Habib Ayadi: Une révolution morte

Un spectre hante les tunisiens ; la mort de la révolution de 2011, on l’impute à la stagnation économique, aux difficultés financières et sociales, à la montée du djihadisme… Mais l’histoire montre que les facteurs politiques et culturels, plus que les chiffres de l’économie, ou les difficultés financières et sociales jouent un rôle déterminant dans le destin des hommes.
La révolution tunisienne devrait normalement apporter la liberté, l’égalité et mettre en place un nouveau pacte social entre les groupes sociaux. Il n’en a été rien. Les tunisiens se trouvent en présence d’une société bloquée : fragilité de l’économie, dégradation des classes moyennes, difficultés rencontrées par les groupes populaires, aggravées par une injustice sociale galopante.
Il ne peut pas en être autrement. Depuis sa naissance, la révolution marchait sur la tête, faute de jambes. Elle a été réduite, rapidement, à une simple dépouille d’un mort « auguste » que certains continuent encore de vénérer, que d’autres voulaient « momifier ». Mais la plupart des acteurs politiques ne voyaient en elle que le résultat d’une émeute qui a réussi.
Pour eux, la révolution est achevée et ses objectifs socio-économiques ne sont que des mensonges mystificateurs.
Ne voir, cependant, dans cette révolution que de simple émeute, c’est se condamner à ne rien comprendre à l’histoire des sociétés. En effet, pour le groupe comme pour l’individu l’insatisfaction est un moteur de comportements dont l’efficacité ne se résume pas seulement aux éclats que la révolution a provoqué.
Les conséquences de cette révolution sont encore perceptibles, on a vu, on verra et on voit déjà, se développer des mouvements plus ou moins factieux, hors des partis politiques et des syndicats. On les voit déjà prendre la tête de mouvements et canaliser leur colère pour promouvoir leurs revendications (mouvement de Kerkanah, Kamour, Gafsa). On voit déjà des hommes politiques, par opportunisme, se ranger derrière ces mouvements.
Si l’on est arrivé là, c’est parce que nous avons commis beaucoup d’erreurs que nous sommes entrain de payer, dont essentiellement.
La première est liée à l’attitude de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT)
Au lendemain du 14 janvier 2011 et après le succès d’une révolution à laquelle l’UGTT a participé activement, la centrale syndicale a refusé d’assurer le rôle qu’elle avait joué après l’indépendance comme acteur principal dans l’élaboration de la politique économique et sociale. Elle a choisi de se cantonner dans un rôle purement revendicatif, créant ainsi un grand vide politique, vite rempli par d’autres, ceux là même qui ont organisé Kasbah I et II ainsi que les islamistes et d’autres prétendants politiques.
Kasbah I et II
L’idée d’organiser ce mouvement est une idée noble et salutaire. C’était l’occasion d’exiger des réformes en profondeur en matière économique, financière et sociale et non de la réduire à un simple marketing politique, c'est-à-dire, essentiellement à de simples revendications politiques.
La constituante
Ceux qui ont vu dans la convocation d’une constituante la priorité, ont relégué au second plan les réformes socio-économiques, ouvrant ainsi la voie à des acteurs politiques qui n’ont pas pris ou tardivement pris part à cette révolution. Ils ont été relayé dans cette nouvelle orientation donnée à la révolution par certains médias et par quelques nostalgiques de la foi naïve qui était celle des révolutionnaires de 1789 en la vertu des textes et des principes en matière constitutionnelle.
Cette décision est lourde de conséquences. Elle a conduit à l’abandon de la procédure de l’article 57 de la constitution, en refusant d’élire un Président de la République et confie la réalisation des objectifs de la révolution à des hommes « d’ordre » qui ont accepté la révolution, non par préférence ou par conviction, mais parce qu’il n’est au pouvoir de personne d’agir comme si elle n’avait pas été. Pour eux, la révolution est une abstraction et on peut ne pas en tenir compte. Malheureusement, ce sont les plus faibles qui ont été frappés de plein fouet par ce comportement.
Au Président intérimaire qui a trahi son serment et qui a ignoré la règle selon laquelle « l’autorité des organes de l’Etat ne peut s’exercer valablement qu’en vertu d’un acte d’investiture accompli conformément à la constitution », et aux chefs de gouvernement qui se sont succédés après la révolution, il faut dire que leur profil d’homme « d’ordre » a rendu leur tâche impossible. Ils ont privilégié les objectifs politiques de la révolution, tout en ignorant totalement ses objectifs socio-économiques, oubliant qu’une transformation du mode d’exercice de la fonction politique est insuffisante, si elle n’est pas accompagnée dans ce que les hommes s’en font du sens et des buts de la révolution, c'est-à-dire, non seulement l’accès à la liberté et la dignité, mais également et surtout à la justice sociale.
L’indulgence des médias
Beaucoup de médias ont été indulgents à l’égard de ces spécialistes et experts autoproclamés et les autres bavards et « péremptoires » qui auront fait diversion, en occupant le devant de la scène politique, alors que la situation économique et sociale du pays chavirait.
Le sens de la révolution
Pourtant, la Révolution tunisienne apparaît comme une sorte de revanche, une rébellion contre des mécanismes politiques et socio-économiques que les tunisiens ont, cependant, créés (Etat moderne, constitution, institutions économiques et sociales, etc.) mais où ils ne s’y retrouvent plus pour s’épanouir, dès lors qu’on est arrivé à la situation où c’est une minorité qui vit et où la majorité ne fait que subir la vie.
Pour cette majorité, qui se sentait exclue de la modernité en marche, la révolution exprime une attente, la réalisation d’un rêve, d’un progrès social et d’impatience populaire, qui jusque-là non-formulés, car ceux qui sont en mesure de les exprimer, étaient tenus à l’écart des centres du pouvoir.
On se rend compte alors que pour cette majorité, la Révolution est beaucoup moins la conquête du pouvoir politique que l’introduction dans le mode de vie de la société tunisienne, des valeurs nouvelles, impliquant la réorganisation des rapports essentiels entre l’individu et la société, le capital et le travail, la répartition du produit social…
C’est donc d’une révolution socio-économique qu’il s’agit, qui se distingue de la révolution politique par l’ampleur des transformations socio-économiques qu’elle accomplit et qui doit prendre le pas sur la révolution politique, celle-ci ne venait normalement que sanctionner les résultats acquis par celle-là.
Le drame de la Tunisie
Le drame de la Tunisie se situe au cœur du personnel politique. La politique fait rêver quand elle est exercée par de grands personnages qui se hissent à la hauteur des circonstances politico-économiques et sociales pour faire avancer les réformes du pays.
Le problème, c’est que beaucoup d’hommes politiques savent qu’il faut changer le système actuel. Mais ils n’ont ni le courage, ni le moteur pour le faire, c'est-à-dire de construire une passerelle vers le monde d’avenir en proposant une meilleure lecture du présent et en dissipant la brume d’angoisse qui recouvre le pays depuis la révolution.
En plus clair, le pays tout entier souffre d’un refus de prise de conscience par les élites dirigeantes et syndicalistes des réalités du nouveau monde.
Pour l’heure, il est manifeste qu’aucun prétendant ne fait envie aux tunisiens, ni par sa personnalité, ni son charisme, c'est-à-dire son ascendant et aptitude exceptionnelle, ni son programme.
La mondialisation de l’économie, les technologies nouvelles ont provoqué une formidable accélération des données politiques, économiques, financières qu’aucun gouvernement depuis 2011, ni de droite ou de gauche, n’a osé entreprendre et qu’aucun parti ni syndical n’a osé proposer jrqu'à ce jour.
La société politique actuelle rappelle d’ailleurs celle décrite par le hollandais R. Riemen « le retour du fascisme 2011), une société de Kermesse dans laquelle les hommes politiques affichent une image et des slogans, dans le but de se s’emparer du pouvoir et de le garder.
Une telle situation, si elle perdure, risque d’éloigner davantage encore plus les tunisiens de l’idée démocratique, perçue non plus comme une promesse mais comme une menace.
La marche vers la démocratie
La marche vers l’ordre démocratique est souvent perçue sous l’angle de la transition, c'est-à-dire d’un processus, long, lent et graduel. Toutefois, la période de transition n’est pas, comme semble l’accréditer, les élites politiques tunisiennes : des mesures d’organisation des structures politiques, des élections, et du respect de l’Etat du droit, mais plutôt une période de changement effectifs des structures socio-économiques.
Les marxistes ne se sont pas trompés, lorsqu’ils ont considéré qu’il est impossible de réaliser une réforme profonde de la situation à la fois économique, sociale et politique d’un pays, seulement par les moyens de la démocratie libérale. Ils ajoutent, la démocratie elle-même est impuissante à s’installer par voie démocratique dans un pays qui l’ignorait. Il faut se plier quelques années durant à un plan de rigueur dans les domaines économiques, financiers et sociales.
En effet, parce que la révolution socio-économique affecte profondément l’organisation sociale, économique et politique, parce que le gouvernement doit faire face à des difficultés marquées par l’urgence ; parce que la rapidité et l’ampleur du changement entraineraient une surcharge de demandes et d’aspirations et, parce que les circonstances où il se trouve, sont tellement mobiles et parfois même orageuses, le gouvernement doit être efficace et rapide dans la décision et dans l’action, surtout que dès le départ, ces gouvernements ont été confrontés à une situation économique difficile, aggravée par la crise économique et financière mondiale. Dans une telle situation, l’exercice des responsabilités politiques et économiques nécessite de la lucidité, de la compétence et du courage.
Quelle ne fut la déception des tunisiens, qui s’imaginaient volontiers, que le changement de régime améliorerait radicalement leur situation économique et sociale, lorsqu’ils ont vu que leur révolution a été récupérée par des acteurs politiques qui n’ont pas pris ou ont pris tardivement part à cette révolution. Quelle ne fut leur déception, lorsqu’ils ont vu confier la réalisation des objectifs de la révolution à de simples amateurs, sourds et muets.
Le règne des amateurs, sourds et muets
Les amateurs
L’expression de gouvernement d’amateurs n’a rien de péjoratif. Le pouvoir politique a été longtemps affaire de personnalité individuelle. En Europe, les pays démocratiques étaient jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale dirigés par des amateurs, c'est-à-dire des hommes ayant ou non des compétences particulières mais dont on attend qu’ils soient dotés d’un solide bon sens et quels soient représentatifs d’un courant d’opinion. Le rôle des ministres est de veiller à ce que les services placés sous leur autorité règlent les problèmes, conformément à la volonté politique.
Depuis la fin de la deuxième Guerre, ils ne peuvent assumer ce rôle que s’ils sont « portés » par des partis politiques dont le rôle est d’encadrer et de diriger la marche vers la conquête du pouvoir.
Parallèlement, les progrès de la technologie et la complexité des tâches dévolues au pouvoir politique ont renforcé le rôle des bureaucrates et des spécialistes sous l’expression de technocrates, qui ont depuis, progressivement conquis la haute administration et même le pouvoir politique.
La politique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou croient, c’est également un métier, c’est une vocation qui exige une formation. Il faut à la fois la vocation et la formation.
Il en résulte que l’exercice du pouvoir, surtout après une révolution, exige des dirigeants solides, visionnaires, empathiques, appliquant une organisation et une vision issues d’une réflexion de longue durée, largement débattue avec les politiques et plus généralement avec les citoyens.
En Tunisie, avec le changement brusque de la société politique, et le départ du président Ben Ali, la politique s’est effondrée laissant s’installer un vide. La forteresse du parti du régime (PSD) s’est à son tour effondrée et écroulée.
Les gouvernements qui lui ont succédé, surtout après le 23 mars 2011, sont en majorité sans expérience, ni convictions révolutionnaires. Cette situation s’est aggravée avec les élections de la constituante.
En effet, depuis l’indépendance, jamais un groupe de députés n’a compté autant de députés qui n’ont aucune expérience politique ou connaissance du fonctionnement des assemblées ou de gouvernement.
A peine élus à la constituante, ils ont découvert le métier de représentant du peuple. Beaucoup ont rejoint les partis ou les listes indépendantes quelques mois avant les élections et ont découvert à peine l’action militante. Parfois même, c’est à peine s’ils ont eu besoin de faire compagne. Ils n’ont ni la compétence de parlementaire, ni l’expérience en politique, ni même une participation à une campagne électorale simplement municipale. A peine élus, les voici, jeunes, novices, persuadés qu’ils ont en mains les clefs pour changer le pays. Ils ont pris une loi constituante, leur accordant, en plus du pouvoir constituant, le législatif.
Face à des députés qui ne doivent leur élection qu’à un parti et un mode électoral des plus mauvais, ils n’ont jamais cultivé l’esprit collectif nécessaire à la mise en place d’un Etat moderne et démocratique.
En quelques mois, les inconnus de la politique, ont créé un mouvement. Piétunant les usages, ils ont réussi à former un parti. Tel est le cas de la El Aridha العريضة ou le C.P.R.
En quelques mois, le C.P.R., surtout, a pu avoir des députés en nombre, renforcé par l’élection d’un président de la République et des ministres.
Traitant du socialisme, Michel Faucaut écrit : « à la différence du libéralisme, le socialisme n’a jamais su définir une manière efficace de gérer parce qu’il est une aspiration avant d’être un mode de gestion. Le but est d’affranchir la conscience aux servitudes économiques : surtout que le monde moderne est l’argent qui ramène toutes les valeurs à une simple unité comptable ».
L’islamisme est avant tout une aspiration, un système trop grand pour un simple parti. Il n’a jamais également su définir une manière efficace de gérer. Le succès des islamistes turcs tient à l’expérience politique de leurs dirigeants. Ils ont tiré la leçon de l’échec de l’expérience d’Arbakān. Son gouvernement n’a pas résisté longtemps à la pression des militaires, les laïcs et la gauche. Ils ont compris que pour exercer le pouvoir, il faut disposer d’une élite, formée politiquement, économiquement et financièrement. Lorsqu’ils ont accédé au pouvoir en 2002, ils avaient une équipe de haut niveau qui leur a permis d’exercer le pouvoir et de le maintenir.
En revanche, en Tunisie, les dirigeants d’Ennahda, suite à leur succès aux élections du 23 octobre 2011 ont revendiqué la formation du gouvernement, faisant ainsi assumer à leur formation, qui n’a ni expérience gouvernementale, ni compétence en matière économique, les conséquences de vingt ans du régime déchu.
La Troïka et à sa tête « Ennahda » n’a jamais trouvé un style de gouvernement susceptible de rassurer et de ramener la confiance. Elle n’a pas d’idée en matière de réforme économique et sociale, pas plus qu’elle ne dispose d’aucune pensée « révolutionnaire », oubliant que leur première mission était de réaliser les objectifs socio-économiques de la révolution.
La vérité, on la connait maintenant. Ils n’ont ni compétence, ni expérience et ont contribué à la dégradation actuelle de la situation économique et sociale.
Ils sont sourds
S’agissant de la fiscalité, il paraissait assez paradoxal, que située au cœur d’un système politico-économique en pleine mutation, qu’elle soit demeurée, immobile et inaltérable. Les gouvernements successifs continuent à voir le système fiscal, un simple outil de financement du budget et que son efficacité n’est jugée que sur les recettes de certains impôts identifiées par l’administration.
Relativement à la fraude, il est certes difficile de savoir combien elle coûte au budget, mais une estimation résultant d’une étude faite par un cabinet anglais après 2011 aboutit aux conclusions suivantes : le nombre de milliardaires en Tunisie aurait augmenté de 17% depuis 2011, leurs fortunes cumulées représenteraient la moitié du budget de l’Etat ; le coût de l’évasion fiscale s’élèverait à 70% du budget. Ce cabinet estime également à 6500 le nombre de Tunisiens dont le patrimoine excède un million de dinars et à 70% d’entre-eux excède 30 millions de dinars.
Selon le site du ministère des finances, 83 % des recettes au titre de l’impôt sur le revenu de personnes physiques sont collectés auprès des salariés ; 75 % des médecins exerçant dans le secteur privé payent moins d’impôts que leurs homologues exerçant dans le secteur public et 34% des avocats ne déposant pas leurs déclaration de revenu.
Avant d’aller plus loin, on peut se poser la question quant à la moralité d’un système fiscal qui concentre l’imposition sur une minorité et se contente de prélever l’impôt sur ceux qui payent déjà l’impôt. C'est-à-dire sur les revenus identifiés par l’administration.
On peut également s’interroger sur les fortunes qui prolifèrent (chefs d’entreprises, banquiers, commerçants, professions libérales…). Ces nantis constituent une aristocratie, toujours plus puissante, alors que leurs revenus déclarés sont sans commune mesure avec leurs revenus réels.
Cela dit, la lutte contre la fraude fiscale n’atteint ses effets que si certaines mesures sont adoptées, dont essentiellement :
Le double système fiscal
Il existe actuellement deux systèmes fiscaux :
- un système de droit commun où l’imposition est déterminée selon la loi.
- un système où le contribuable détermine seul l’essentiel de la vérité fiscale.
Pour cette catégorie, l’Etat ne pourra faire admettre son autorité qu’en renforçant l’administration et le développement des technologies de l’information et en mettant fin à cet Etat fainéant.
L’Etat fainéant
Cette expression, désigne les rois mérovingiens, après la mort du roi Dagobert. Il s’agit d’un Etat dépourvu de l’autorité nécessaire pour imposer ses décisions. L’Etat vivait sur le passé ou plus exactement sur ce qui a pu être conservé.
En matière fiscale, on parle d’Etat « fainéant » lorsque le pouvoir se contente de légiférer sans fournir l’effort nécessaire pour empêcher l'émergence des zones de non-droit, qu’elles soient fiscales, économiques, socioprofessionnelles alors qu’il dispose des moyens et des technologies pour augmenter le produit fiscal. Telle est la situation fiscale maintenant de la Tunisie.
Ils sont muets
Il fut un temps où les ministres, pour faire passer des réformes, multiplient leur rapport avec le peuple. Ils sont généralement, non seulement élus, mais avaient des réseaux, une légitimité, autre que celle de la compétence.
La nouvelle donne médiatique a modifié, en l’affaiblissant, leur fonction parce que le culte du spectacle passe avant la politique. Les ministres ne parlent plus directement au peuple, mais s’imposent abondamment en images. Ils sont trop souvent obsédés par leur existence médiatique.
Cette « spectualisation » a des effets jusqu’à leur carrière. Le succès d’un ministre à la télévision garantit son maintien au gouvernement. Ce n’est plus la télévision qui se déplace mais c’est le ministre qui vient dans le plateau de la télévision. Parfois, même en cas de crise, il est sommé de comparaître.
Les attentes envers lui ne sont plus les mêmes. On espère encore de lui qu’il fasse un grand discours politique ou une capacité de dire une vérité au peuple. Il n’en est rien : pas un mot sur la loi de finances pour 2018, rien sur l’augmentation des carburants ? pas un mot sur le maintien de privilèges quant à l’énergie et les carburants.
A l’assemblée des représentants du peuple, les députés ne sont plus influents. Il n’y a plus de discours dans la tribune, il n’y a plus de « vedetteS », attendus, écoutés et commentés par la presse. Elle n’est plus la maitresse du jeu politique et sa prise sur le gouvernement est limitée.
Que faire
Cela dit et pour l’instant, l’élite politique au pouvoir, sept ans après la révolution, s’est révélée incapable d’apporter la réponse ou même le début d’une réponse crédible aux aspirations légitimes des tunisiens. Beaucoup se sont évertués à promettre tout et son contraire. Ils n’ont pas compris jusqu’à présent que leurs discours tournent à vide.
La vie politique
La vie politique (à droite et à gauche) n’est faite que des querelles et des batailles tactiques dirigées par de vieux routiers de la politique la plus traditionnelle, et qui restent au pouvoir comme s’ils sont indispensables à la suivie du pays et comme si la politique se réduit à leur présence. Les réformes proposées jusque là sont celles qui correspondent à un monde qui n’est plus. Elle souffre de l’incohérence des politiques conduites dans les années 1970.
L’idée de gouvernement d’Union nationale s’inscrit dans ce cadre. La cohabitation difficile des partis qui d’une part n’ont pas de masse pour tenir le pays et procéder à des réformes et d’autre part des partis incapables de se démarquer les uns des autres sur le fond. Ils n’ont en fait que leurs idéologies ou croyances pour faire la différence.
La vie politique qui se dessine nécessite autre chose que des idées et des méthodes des années 1970 pour permettre aux jeunes de se faire entendre.
Le pays a besoin d’un fort choc et un renouveau politique avec un renouvellement massif de l’élite au pouvoir. Précisément, les objectifs de la révolution ne peuvent être atteints que dans le cadre d’un choc politique, économique et social.
La Tunisie a d’abord besoin de grands partis politique (droite ou gauche) et non pas de simples embryons de parti politique ou de petits fonds de commerce politique qui n’ont ni assise populaire, ni programme. Elle exige des dirigeants solides, visionnaires, qui réfléchissent sur le monde qui vient, qui évaluent les conséquences des technologies, du climat, de la santé de l’information et l’intelligence artificielle etc. Il faut faire comprendre aux élites politiques et syndicales que le monde a changé. Qu’il se transforme et rapidement.
Les chefs de gouvernement
Un chef du gouvernement est un responsable politique. Il s’impose en général au terme d’une compagne électorale comme celui qui aura la confiance du Président de la République et de l’assemblée et en même temps la légitimité de l’autorité requise pour être le chef d’une majorité d’un parti ou d’une coalition.
Le plus important pour lui est de scissure de l’adhésion nécessaire pour mener la politique en vue des réformes projetées en expliquant au peuple les difficultés du pays et les sacrifices exigées.
Depuis 2011 les chefs du gouvernement ont manqué d’autorité et surtout de compétence. Affaiblis par des ouvertures politiques discutables, la plupart des gouvernements d’après la révolution n’ont jamais cultivés l’esprit collectif nécessaire à la mise en œuvre des réformes indispensables.
Il ne peut pas en être autrement pour les deux chefs du gouvernement d’après les élections de 2014 et qui ne doivent rien à aucun parti. Ils ne se sont pas, non plus, imposés par leur compétence politique ou par leur efficacité en matière économique et financière. Ils sont incapables de s’écarter de la sphère d’attraction du Président de la République. Leur seule référence, c’est le Président de la République ; leur seule légitimité, c’est d’avoir été choisi par lui.
Or, L’expérience montre que la démocratie ne peut être fondée uniquement sur des élections ou plus clairement sur la légitimité populaire des dirigeants : il faut, d’une part un chef de gouvernement, chef d’une majorité parlementaire qui exerce effectivement les compétences à lui dévolues par la constitution et d’autre part, une assemblée puissante, des députés, responsables et compétents et ayant un lien direct avec le peuple.
Mais que peut-on attendre des hommes de circonstance et non de programme et des députés qui ne doivent leur élection qu’à des partis et un mode électoral des plus mauvais. Ils n’espèrent leur réélection qu’au succès de leurs partis.
La vie politique actuelle ne fait que renforcer le sentiment de défiance des citoyens à l’égard de la classe politique. Le désaveu des partis politiques en place, le niveau faible de l’empressement des tunisiens pour l’inscription sur les listes électorales aux municipales et la faible participation aux élections en témoignent.
Mode électoral
Des élections nouvelles, avec un changement au préalable du mode électoral, est nécessaire.
Il ne fait aucun doute, que le système actuel de la proportionnelle avec les plus forts restes, a contribué au malaise politique et économique actuel. Il a tué la politique et a exclu de la compétition tous ceux qui pourraient apporter une contre-parole, appeler aux réformes. Il a conduit à un renforcement du caractère idéologique des partis au pouvoir et à l’opposition.
En Europe, élection après élection, les modes de scrutin changent. C’est le besoin de stabilité ou plus exactement la peur de l’insécurité qui domine.
En France, inaugurée en 1945, la proportionnelle n’avait point donné les résultats qu’espéraient ses partisans. Comme le souligne M. Duverger, « Les électeurs détestent le système de « listes bloquées » qui leur donne l’impression d’une carte forcée ; un régime électoral impopulaire détesté ». Une loi du 9 mai 1951 est intervenue combinant représentation personnelle et scrutin uninominal.
La Vème République a rompu avec la proportionnelle et l’a remplacée par un système uninominal majoritaire.
Ce système a coïncidé avec une plus grande stabilité politique et une meilleure efficacité économique.
En 1986, La proportionnelle est rétablie mais vite abandonnée parce qu’elle a permis à la droite de siéger à l’Assemblée.
Le système appliqué actuellement est uninominal majoritaire à deux tours.
L’Allemagne, après le scrutin majoritaire, a introduit une proportionnelle partielle. Cette réforme a permis à l’extrême droite d’accéder à l’assemblée et a conduit à une certaine instabilité.
En Italie, l’adoption à l’automne 2017 d’une loi électorale à forte dominante proportionnelle a ouvert la voie à l’extrême droite.
En Tunisie s’il l’on considère les deux buts essentiels : la restauration et le prestige de l’Etat et la sortie du pays de la crise économique et sociale, il est nécessaire de rompre avec le mode électoral actuel et le remplacer par l’uninominal. Toutefois, pour tenir compte dans la représentation nationale de certaines catégories politiques, il est souhaitable d’équilibrer l’uninominal par une dose de proportionnelle.
Habib Ayadi
Professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis2
- Ecrire un commentaire
- Commenter

C'est un bon article